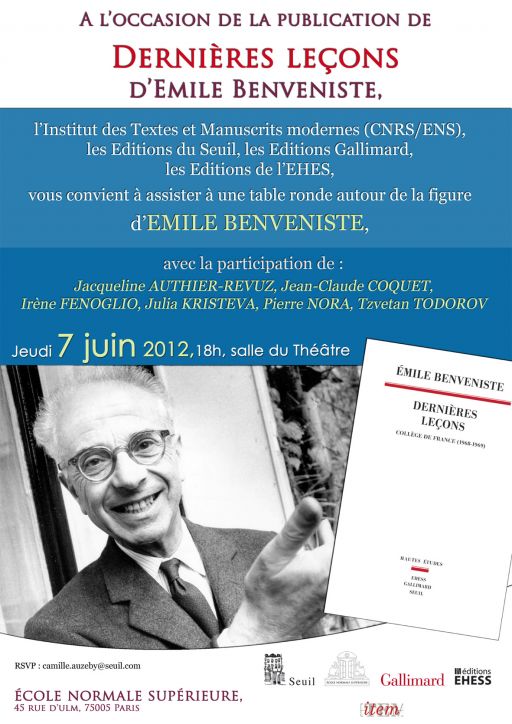|
Emile Benveniste (1902-1976), à l’ENS
Un linguiste qui ne dit ni ne cache, mais
signifie
Qu’est-ce qu’un grand linguiste ? Je risque une définition :
d’apparence méticuleuse et froide, cette personne (souvent un homme) étudie les langues, pour découvrir de nouvelles propriétés du langage comme capacité centrale
de tous les êtres parlants, et de ce fait accompagne et accélère des étapes décisives de l’aventure humaine. Je pense
à Scaliger et Ramus, qui au XVIe
siècle ont favorisé la constitution
et le développement des langues nationales. À Lancelot et Arnauld dont la Grammaire générale et raisonnée (1660) inscrit le sujet cartésien
dans la syntaxe de la langue. À la philologie comparée de Franz Bopp et Rasmus Rask qui, en démontrant la parenté
du sanscrit avec les langues indo-européennes, confirment le poids de
l’histoire par l’activité évolutive
du langage, et l’historicisme s’impose comme approche incontournable du monde et
de la société.
Mais
Benveniste, aujourd’hui ? – Permettez-moi un détour.
Les
conflits tragiques du XXe siècle tendent à faire oublier qu’il fut
aussi le temps d’une exceptionnelle exploration du langage mis au cœur de la condition
humaine : c’est la langue qui conditionne, contient et éclaire toutes les expériences humaines. La
phénoménologie, la logique formelle, la philosophie analytique, le structuralisme, la grammaire générative,
les sciences de l’homme interrogeant dans le langage le sens des comportements
et des institutions, sans oublier la psychanalyse qui annexe le sexe et empiète sur la biologie : tous
se sont développés alors même qu’une explosion sans précédent des formes
littéraires, des avant-gardes artistiques et des singularités stylistiques
bouleversait le domaine des lettres. Observée avec recul, cette lucide aventure semble annoncer la
marée des nouvelles et virtuelles hyperconnexions,
qui font éclater les systèmes de signes conventionnels et promettent autant de
liberté que de chaos.
Tout le monde communique
aujourd’hui, mais rares sont ceux qui perçoivent la consistance et toute l’étendue du
langage. À l’époque où Benveniste donnait ses Derniers cours, cette idée
selon laquelle le langage détermine les humains d’une autre façon et plus
profondément que ne le font les rapports sociaux commençait à devenir une pensée dangereuse : une
véritable révolte contre les
conventions, l’ « ordre
établi », l’ « État policier », le marxisme doctrinaire et
les régimes communistes. À Varsovie, en Italie, en Tchécoslovaquie, dans les
Républiques baltes alors soviétiques et ailleurs, la sémiologie était synonyme de liberté de penser. Assez
logiquement, c’est à Paris (où la recherche française montrait un grand
dynamisme, que ce soit à travers la Section
de sémiologie du Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France,
la revue Communications ou les
publications d’Emile Benveniste, Roland Barthes et Algirdas Julien Greimas, parmi d’autres) que
naquit l’idée de réunir ces courants mondiaux. Et c’est tout aussi logiquement
que, sous l’autorité inspirée de Roman Jakobson, la présidence de Benveniste
s’imposa à tous. Le Symposium
international de sémiotique créé en août 1968 devait constituer les bases de l’Association Internationale de sémiotique (AIS) dont Emile Benveniste devint officiellement
le Président en 1969. Jeune étudiante, venue de l’Est, j’ai eu l’honneur
d’être nommée « secrétaire
générale » de la section « Recherches Sémiologique » de la revue
Social science information (Unesco), puis de l’AIS : autant tâches qui ont
développé et consolidé mes liens avec le grand linguiste.
Au sein
de ce foisonnement dans lequel son oeuvre s’inscrit
pleinement, et alors que la linguistique semble pressée d’urgences
techniques dans une société en perte de sens et cerclée par la « com », les Derniers
cours d’E. Benveniste esquisse
des « théories générales » qui contribuent à sonder des logiques profondes qui
traversent jusqu’à nos écritures numériques. Et nous
aident à les problématiser : Sont-elles des chats en manque de
« subjectivité », ou au contraire des voies
d’ « engendrement » de nouvelles « signifiances »,
pour reprendre la terminologie du dernier Benveniste ?
Comment
la « linguistique générale » de Benveniste nous invite-t-elle à
ouvrir ces questions, et bien d’autres, face aux péripéties du SENS dans le
langage, ou ce qu’il en reste dans les « éléments de langages » et la
« com » d’aujourd’hui? Voilà un sujet de thèse que je suggère
aux jeunes chercheurs. Je me limiterai à quelques remarques, et je vous prie
d’en excuser la simplification.
La double signifiance
A.
Benveniste
laisse une « œuvre inachevée », dit-on parfois, la formule risquant d’en minorer la
portée. Inachevée, certes, puisque
l’attaque a laissé l’homme dans l’insoutenable situation d’un grand linguiste privé de parole et
paralysé. Mais « inachevée » surtout dans un sens absolument nécessaire, parce que telle
est l’expérience du langage qu’il a faite et théorisée : un
chemin, nécessairement ouvert. Pourquoi ?
En un siècle où la diversité des courants de pensée multipliait les pistes et les interrogations tant
épistémologiques qu’esthétiques, l’enfant juif de l’Ecole rabbinique devint un
homme des Lumières. Un agnostique qui ne se contente pas de repérer et de
commenter le détail morphosyntaxique, mais pratique une l’interrogation permanente des catégories fondamentales, linguistiques
et/ou philosophiques
[1]
. Une patiente déconstruction dont il n’emploie pas le terme, mais qu’il
pratique avec une clarté classique. Et qui culmine en cette devise d’Héraclite,
dans laquelle il se reconnait et qu’il revendique « Oute legei, oute kryptei, alla semainei
[2]
».
Ni dire, ni cacher, mais signifier.
Ce serait cela, la propriété fondamentale du langage, signifier : Benveniste
réhabilite et développe comment ça signifie par et dans les seules propriétés
du langage. Le langage ne se
contente pas de dire, il ne cache pas non plus, il signifie. Le linguiste en
prend le chemin, pour déterminer
comment signifier s’engendre -
non pas du fait d’une impulsion extérieure, mais dans l’appareil formel du
langage lui-même.
Il
annonce, dès la Première leçon : « Nous posons, quant à nous, que la nature essentielle de la langue,
qui commande toutes les fonctions qu’elle peut assumer, est sa nature signifiante./…/Qu’est-ce
donc que « signifier » ?
Nous
sommes le 2 décembre 1968, sept mois après le fameux Mai 68.) Le lecteur naïf,
à ce moment comme aujourd’hui, s’étonne : est-ce si original ? à quoi bon une langue si
elle ne signifie pas quelque chose ?
Certes. Mais savez-vous ce que vous entendez au juste par
« signifier » ? Et si « communiquer »,
« vouloir dire », « porter un message » ne se confondaient
pas avec « signifier » ? Central en philosophie du langage,
mais en tant que porteur de « vérité » (la philosophie confond
« sens » et « vérité »), le sens – pour cette raison même- n’est pas vraiment le problème
des linguistes, rappelle Benveniste (PLG2, 1967, p. 216) : soit
« écarté » car suspecté d’être trop subjectiviste; soit reconnu mais
« réduit » (Bloomfield, Harris). Selon Benveniste, au contraire, « signifier » constitue un
« principe interne » du langage (Cours
3). Avec cette « idée neuve »,
souligne-t-il, « nous sommes jetés dans un problème majeur, qui embrasse la linguistique et au-delà ».
Si quelques précurseurs
(Locke, Saussure et Pierce) ont démontré que nous « vivons dans un univers de signes » dont la
langue est le premier, suivi des signes d’écriture, de reconnaissance, de
ralliement, etc. (Cours 1),
Benveniste se situe dans leur sillage et commente leurs apports, mais il prend
ses distances : en quoi consiste la signifiance spécifique du langage, sa
manière particulière de signifier ? Il entend démontrer comment l’appareil formel de la langue la rend
capable non seulement de « dénommer » des objets et des situations,
mais surtout de « générer » des discours aux significations originales, aussi
individuelles que partageables dans les échanges avec autrui. Mieux même, non content de s’autogénérer,
l’organisme de la langue génère
aussi d’autres systèmes de signes qui lui ressemblent ou augmentent ses capacités, mais dont elle est le seul système
signifiant capable de fournir une interprétation.
B. Ces Derniers
Cours prennent tout leur sens si on les lit au regard des deux volumes des Problèmes de linguistique générale ( 1966 et 1974), ainsi que des Notes sur Baudelaire de la
même période.
Dès le premier tome, cette linguistique générale qui s’écarte de la
linguistique structurale mais aussi de la grammaire générative qui dominent le
paysage linguistique de l’époque, et débouche sur le fait que signifier est un
acte entre deux sujets : « je » et « tu ». Il avance une linguistique du discours, basée sur l’allocution et le dialogue, et ouvre l’énoncé vers le processus d’énonciation, la subjectivité et l’intersubjectivité. Sa pensée ne quitte pas la linguistique stricto sensa, mais lui adjoint un vaste champ
interdisciplinaire. Attentif à la philosophie analytique (les énoncés
performatifs) mais aussi de la psychanalyse freudienne, Benveniste conçoit la subjectivité dans l’énonciation comme un émetteur bien plus complexe que le sujet
cartésien. Comment ? Il
l’élargit à l’ « intentionnel » (emprunté à la phénoménologie
existentielle, via les travaux du linguiste-phénoménologue Hendrik Josephus Pos).
De surcroît, et sans y paraître, il
esquisse une ouverture vers le
sujet de l’ « inconscient ». On ne dira jamais assez que
Benveniste est le premier, et à ma connaissance le seul grand linguiste, qui ait
pris au sérieux la place du langage dans la théorie freudienne de
l’inconscient. Pas vraiment « structuré comme un langage », mais travaillé par une « force
anarchique » (pulsionnelle ?) que le langage « refrène et
sublime », bien que par « déchirures » elle puisse
introduire en lui un « nouveau
contenu, celui de la motivation
inconsciente et un symbolisme spécifique », « quand le pouvoir de la
censure est suspendu
[3]
».
Une nouvelle dimension de la linguistique générale selon Benveniste se
révèle cependant dans le second tome de ses Problèmes de linguistique générale . En discussion avec Saussure et sa conception des
éléments distinctifs du système linguistique que sont les signes, Benveniste
propose deux types dans la signifiance du langage :
« le » sémiotique et
« le » sémantique.
Le sémiotique (de « semeion »,
ou « signe », caractérisé par son lien « arbitraire » – résultat d’une convention
sociale – entre « signifiant »
et « signifié ») est un sens clos, générique, binaire,
intralinguistique, systématisant et
institutionnel, qui se définit par une relation de « paradigme » et
de « substitution ». LE sémantique s’exprime dans la
phrase qui articule le
« signifié » du signe, ou l’ « intenté »
(fréquente allusion à l’ « intention » phénoménologique de
Husserl). Il se définit par une relation de « connection » ou de
« syntagme », où le
« signe » (le sémiotique)
devient « mot » par l’ « activité du locuteur ».
Celle-ci met en action la langue dans la situation du discours adressé par la « première
personne » (Je) à la « deuxième personne » (Tu), la troisième
(Il) se situant hors discours.
Formulée en
1967/1968 (PLG2, p. 63 sq. et p. 215 sq.) devant le Congrès de la Société de Philosophie
de langue française, puis devant le Congrès de Varsovie fondateur de l’AIS en
1968 (PLG2, p. 43 sq.), cette conception duelle de la signifiance ouvre un nouveau champ de recherche. Benveniste insiste sur le dépassement de
la notion saussurienne du signe et du langage comme système, et souligne son importance, à la fois intralinguistique : ouvrir une nouvelle dimension de la
signifiance, celle du discours (le sémantique), distincte de celle du signe (le
sémiotique
[4]
);
et translinguistique : élaborer une métasémiotique des textes et des œuvres, sur la base de la sémantique de l’énonciation (PLG2,
p. 66). Et donne une idée plus
précise des perspectives immenses
qui s’ouvrent ainsi : « Nous sommes tout à fait au commencement »,
aussi est-il encore « impossible de définir de manière générale » où mènera cette orientation qui, traversant la linguistique,
« obligera à réorganiser l’appareil des sciences de l’homme » (PLG2,
p. 238).
Entre le second tome des Problèmes de linguistique générale et
le Baudelaire, les Derniers Cours se proposent donc :
- dans
un premier temps de démontrer que « signifier », qui constitue la « propriété initiale,
essentielle et spécifique de la langue », ne s’enferme pas dans les unités-signes
(telles que le concevait Saussure), mais « transcende » les fonctions
communicative et pragmatique de la langue ; et,
- dans
un second temps, de spécifier les termes et les stratégies de cette
« signifiance » en tant qu’elle est une « expérience »
intra- et inter-subjective, à proprement parler vitale (comme il
l’avait annoncé dans PLG2, p. 217 : « Bien avant de servir
à communiquer, le langage sert à
vivre » 1.1969).
L’écriture prend
place dans ce mouvement : centre et
relais de la signifiance.
Comment ?
La « double
signifiance » de la langue est développée par le levier de l’écriture, qui
réalise et révèle sa capacité de « production » et
d’ « engendrement ». C’est la touche originale du Cours Le terme d’ « écriture »
est alors au centre de la création
philosophique et littéraire en France
[5]
.
Benveniste ne s’y réfère pas
explicitement, bien qu’il s’y montre très attentif dans nos échanges de cette
période ; mais il en construit le concept dans le cadre de sa théorie
générale de la signifiance de la langue.
En discussion avec la sémiologie de Saussure qui , en « confondant l’écriture avec l’alphabet, et la
langue avec une langue moderne », postule que l’écriture est
« subordonnée à la langue » (Cours
8), Benveniste interroge -l’acte d’écrire, -l’apprentissage
de l’écriture et - les types
constitués au cours de l’histoire. En prenant soin cependant de
souligner qu’il ne cherche pas
l’« origine de l’écriture », mais les diverses solutions de la « représentation
graphique » ou « iconique » de la signifiance (Cour 9).
-
L’écriture est appréhendée d’abord comme un
« système sémiotique » particulier ; distinct de la parole, une « abstraction de haut degré » : le
locuteur écrivant s’extrait de l’activité verbale « vivante »
(gestuelle, phono-acoustique, reliant soi à autrui dans un dialogue) et la
« convertit » en « images », en « signes tracés à la
main ». Bien plus que sur la
fonction « utilitaire » de l’écriture (mémoriser, transmettre,
communiquer le message), Benveniste insiste sur le fait que cette « iconisation de la pensée » (Cours 8) est une « expérience unique »
du « locuteur avec lui-même » : ce dernier « prend conscience » que ce « n’est pas de la parole
prononcée, du langage en action » que procède l’écriture.
« Global », « schématique », « non grammatical »,
« allusif », « rapide », « incohérent », il existe un langage intérieur,
« intelligible pour le parlant et pour lui seul », qui confronte
celui-ci à la tâche considérable de réaliser une « opération de
conversion de sa pensée » dans une forme intelligible à d’autres. L’iconisation opère à cette charnière, entre le langage
intérieur et sa transmission aux
autres.
Ainsi comprise, la
« représentation iconique » construit ensemble la parole et l’écriture : elle « va de pair avec
l’élaboration de la parole et l’acquisition de l’écriture ». A cette étape
de sa théorisation, et à l’encontre
de Saussure, Benveniste remarque que, loin d’être « subordonné » à la
parole, le signe iconique associe la pensée propre au « langage
intérieur » parallèlement au
graphisme et à la verbalisation : « La représentation iconique se
développerait parallèlement à la représentation linguistique », ce qui
laisse entrevoir une autre relation entre pensée et icône, « moins
littérale » et « plus globale » que la relation entre pensée et parole (Cours 8).
Cette hypothèse associant l’écriture au
« langage intérieur », qui sera modifiée plus loin, renoue avec les
interrogations antérieures de Benveniste sur la « force anarchique » de
l’inconscient freudien (PLG1, p. 78). Le « langage intérieur »
du parlant-écrivant ne se limiterait
pas à la propositionnalité de l’ego transcendantal de la conscience et à son « intention », mais pourrait dessiner en creux, dans sa
théorie de la subjectivité, une diversité d’espaces subjectifs : des typologies ou topologies des
subjectivités dans l’engendrement de la signifiance. L’ « expérience
poétique » de Baudelaire, j’y reviendrais, confirme et précise cette
avancée.
-
L’histoire de l’écriture un nouvel
ajustement du rapport langue/écriture, et constitue une nouvelle étape dans la théorie de la signifiance chez
Benveniste. Pictogrammes, écriture monosyllabique (chinois), polysyllabiques
(sumériennes, akkadiennes-sémitiques, égyptiennes), puis alphabétiques – consonantique
(l’hébreu), vocalique (grecque)…
A partir de la « double signfiance » (le sémiotique/ le sémantique), deux types de langues se
dégagent à partir de leur rapport à l’écriture : celles où
prédominent l’étymologie ou le
sémantique (l’hébreu, et déjà chez les Phéniciens) ; celles, ensuite, où
la vocalisation distingue voyelles et consonnes, et où les variations grammaticales, qui détruisent souvent les relations étymologiques, conduisent à un affinement
du système flexionnel.
Une « ligne de partage » se dessine aussi : à l’est (en Mésopotamie, en Égypte et jusqu’en
Chine) prédominent des « civilisations de l’écrit » caractérisées
par le primat de l’écriture, où le scribe (le « sage
calligraphe » en Chine) joue un rôle central dans l’organisation de la
société ; tandis qu’à l’ouest dans le monde indo-européen, une dévalorisation,
voire un certain « mépris » de l’écriture (chez Homère, grapho ne
signifie que « gratter »), prévalent (Cours 14).
-
L’auteur
soutient non seulement l’écriture n’est pas
subordonnée au langage, non seulement elle est parallèle à la langue (et aux types de langues), mais de surcroit qu’elle
les prolonge. Comment ?
D’une part, l’iconisation déclenche et
affine la formalisation de la langue, de sorte que progressivement l’écriture
se littéralise. « Elle sémiotise tout » : l’écriture est un système de signes qui « ressemble
beaucoup plus au langage intérieur qu’à la chaîne du
discours » (Cours 12). Dès lors, et d’autre part, cette
proximité de l’écriture avec le langage intérieur conduit à repenser le langage
intérieur lui-même : puisque l’écriture est toujours déjà co-présente au langage intérieur, le langage intérieur ne serait-il pas déjà une
proto-écriture ? Une nouvelle caractéristique du « langage
intérieur » se précise ici : « avant » même le scribe
sacré, c’est logiquement le langage intérieur qui nous « sacre » en formulant le
« mythe ». Telle une écriture de la « globalité » , un « train d’idée » qui raconte une « histoire entière », ce
« langage intérieur » serait-il une narrativité
« intérieure » ? S’agit-il d’une sorte de
« fiction », dont Husserl disait qu’elle constitue
l’ « élément vital de la phénoménologie » ? Des « fantasme
originaire » de Freud ? Des rêveries ? Des « enveloppes
narratives » des cognitivistes,
qui les présupposent antérieures à la compétence syntaxique ?
-
Arrivé
à ce point, Benveniste inverse l’hypothèse initiale au sujet de l’écriture. En tant qu’ « opération » dans le « procès
linguistique », c’est l’écriture
qui est « l’acte fondateur » : elle a « transformé la figure des
civilisations », « la révolution la plus profonde que l’humanité a
connue » (Cours 14). Cette particularité de l’écriture dans
son rapport à la langue renforce aussi une ultime constatation : la langue et l’écriture « signifient
exactement de la même manière ». L’écriture se réapproprie la parole
pour transmettre, communiquer, mais aussi reconnaître (c’est le sémiotique) et
comprendre (c’est le sémantique). L’écriture est partie prenante de l’interprétance de la langue. Ce relais de la parole fixée dans un système de
signes reste un système de la
parole, à condition d’entendre cette dernière comme une signifiance susceptible
d’engendrements ultérieurs d’autres systèmes de signes.
Entendons :
il n’y a pas d’instance de sens extérieure ou transcendante au langage, c’est
en la coprésence de langage et de
l’écriture que consiste sa capacité de signifier, le « transcendant »
est immanent à l’autsémiotisation du langage par l’écriture.
Pas à pas, la théorie de Benveniste intègre donc tout référent et, implicitement, l’infini de
la Res divina –par définition extérieure au monde humain. Le projet linguistique
d’examiner comment la langue signifie, se révèle plus ambitieux : il est
implicitement métaphysique, philosophique.
Signifiance
et expérience
Le Deuxième
volume des Problèmes développe cette
dimension, lorsque Benveniste dira que l’acte de signifier,
irréductible à la communication et
aux institutions, ne transcende le
« sens donné » - retenez cette allusion à la transcendance- que par
l’ « activité du locuteur mise au centre ». La notion
d’ « énonciation », sera
alors comprise désormais comme une
« expérience »- au double sens d’Erlebnis et d’Erfharung- - modifie considérablement l’objet de la
signifiance et/ou du langage (PLG2, p. 67 sq. et p. 79 sq.).
Les termes désignant la « dialectique singulière »
de cette dynamique du langage varient : «engendrement », mais aussi
« fonctionnement », « conversion » de la langue en
écriture et de la langue en discours,
« diversification » ; la langue étant définie comme « production », « paysage mouvant »,
« lieu de transformations ». L’ « engendrement » de la
signifiance selon Benveniste s’engage profondément dans le processus d’un avènement de la
signification pré- et translinguistique, et vise trois types de relations d’engendrement : relation d’interprétance (propriété fondamentale, la langue
étant « le seul système qui peut tout interpréter ») ; relation
d’engendrement (entre systèmes de
signes : de l’écriture alphabétique au braille) ; relation d’homologie (en référence aux
« correspondances » de Baudelaire).
Le sujet de l’énonciation lui-même
devait se ressentir de cette
mobilité. Dans ce paysage mouvant
de la langue, et au regard de l’écriture qui a contribué à le faire apparaître,
une réflexion sur l’expérience spécifique de l’écriture que représente le « langage poétique »
s’imposait. Benveniste aborde le sujet dans ses Notes manuscrites sur Baudelaire
[6]
,
de la même période (de 1967 à 1969),
en contrepoint de la lecture structuraliste des « Chats » de Baudelaire
par Roman Jakobson et Claude
Lévi-Strauss, et en écho aux indications des Derniers cours .
Plus proche du
« langage intérieur » que du discours, le langage poétique exige de
l’analyste qu’il « change d’instruments », comme le voulait Rilke
[7]
(commenté par le jeune
Benveniste). Cette « langue
différente » en effet nécessite une « translinguistique » :
le message poétique, « tout à
l’envers des propriétés de la communication » (20, f10/f204), parle une émotion que le langage
« transmet » mais ne « décrit » pas (12, f4/f56). De même, le référent du langage poétique est « à l’intérieur de l’expression », tandis que dans le
langage usuel l’objet est hors
langage. Le langage poétique est « sensitif », il « procède du corps du poète », « ce sont des impressions
musculaires », précise Benveniste. « ne s’adresse qu’aux entités qui
participent à cette nouvelle communauté : l’âme du poète, Dieu/la nature,
l’absente/la créature de souvenirs et de fiction » (23, F33/ f356).
Pourquoi Benveniste choisit-il Baudelaire pour illustrer son propos ? Parce que ce dernier opéra la
« première fissure entre le
langage poétique et le langage non poétique », tandis que chez Mallarmé
cette rupture est déjà consommée (23, F35/f358).
Contemporaines des Dernières
leçons, ces notes sur
l’expérience poétique de Baudelaire rejoignent les réflexions sur la « force anarchique » à
l’œuvre dans l’inconscient et que la langue « refrène et sublime »
(PLG1, p. 77). Elles sont aussi à l’écoute de la poétique de l’Inde ancienne
telle qu’elle apparaît dans les textes sacrés que le sanscritiste Benveniste
maîtrise à fond, ces dernières réflexions entrent en résonance avec la fin de
ces années 1960, où les révoltes sociales et générationnelles, appelant à
mettre l’ « imagination au pouvoir », cherchaient dans
l’expérience de l’écriture
(d’avant-garde ou féminine) les
logiques secrètes et innovantes du sens et de l’existence. Dans l’absence de
toute référence explicite à la sexualité, ce n’est pas à la théorie freudienne
de la sublimation que fait penser cette linguistique générale de l’expérience et de la subjectivité, mais au cheminement – innommé –
de Martin Heidegger (Acheminement vers la
parole, 1959) : la parole, Sage, sans son ni communication, mais
pensée intérieure qui se réalise dans le silence de la production mentale d’un
« « venir de la langue ».
En
définitive, pour
Benveniste, l’écriture comme graphisme et comme expérience poétique –
de Baudelaire au surréalisme – croise certes la définition par Heidegger du « langage qui parle
uniquement et solitairement avec soi-même » et qui rend possible la
sonorité. Mais pour s’en écarter aussitôt, car à ce « laisser-aller » qui serait l’essence du
langage, sourdement menacé de devenir « insensé », chez le deuxième
Heidegger, les remarques allusives des Dernières
leçons et du Baudelaire apposent,
plus qu’elles n’opposent, la vigilance du linguiste pour lequel « le discours comporte
à la fois la limite et l’illimité », « l’unité et la diversité »
(Cours 13)
En effet, Benveniste ne manque jamais
d’insister sur « syntagmation » – probablement « reflétant
une nécessité de notre organisation cérébrale » (PLG2, p. 226) – qui
confère à l’ « instrument du langage » sa capacité de coder en
codifiant, de limiter en se limitant, et d’assurer ainsi la sémantique d’un
discours intelligible, communicatif, en prise sur la réalité. Il ajoute
cependant que, parallèle à la langue et son relais, l’écriture comme représentation graphique et comme expérience
poétique, bien que plus proche du « langage intérieur » que du
« discours », n’élimine pas ses vertus pragmatiques. Mais qu’elle se risque à déplacer les limites de la langue par
l’engendrement de systèmes signifiants singuliers (le poème) et néanmoins
partageables dans l’ « interprétance »
de la langue elle-même. Ni tyrannie
institutionnelle ni hymne
rêveur, la signifiance qu’esquisse
ce dernier Benveniste est un espace de liberté.
Et Dieu, dans cette alchimie du
Verbe ? Dans la terrible
épreuve de l’aphasie, et alors que j’avais raréfié mes visites, il m’a fait
demander par sa sœur. Etait-ce le jour où je lui ai apporté son livre publié en 1929 que j’avais
trouvé chez un antiquaire, The Presian religion, en anglais ? Il s’est mis a écrire avec son doigt sur mon chemisier. Troublée,
embarrassée, j’ai fini par lui tendre une feuille de papier où il écrit THEO, avec
le sourire qu’on lui connaît de la photo publiée par le Nouvel Observateur et
dans le livre recueillant ses Dernières
leçons. Graffiti du hasard dont
il ne convient pas de chercher le sens ? On peut le penser. Je ne le crois
pas. L’aphasie motrice n’avait pas détruit complètement l’intelligence. Ce THEO
me restera à jamais énigmatique. En écrivant ma préface, j’ai découvert des détails
significatifs de la vie de ce grand linguiste qui, appuyés sur les derniers écrits, éclairent me
semble-t-il cette écriture d’un langage intérieur privé de voix.
Né au cœur de l’Empire ottoman, le petit
Ezra arrive à Paris à 9 ans, élève à l’École rabbinique de la rue Vauquelin,
jusqu’à 1919 : il étudie 6 ans durant le Talmud Thora, avant que Sylvain Lévi, à moins que ce ne soit Salomon
Reinach, ne le dirige vers les études de lettres, puis vers le grand Antoine
Meillet dont il sera le successeur à l’EPHE, enfin au Collège de France. Ami
des révoltés surréalistes, trotskistes et communistes, il signe en 1925 le
Manifeste surréaliste « La Révolution
d’abord et toujours » : « Nous considérons la révolution sanglante
comme la vengeance inéluctable de l’esprit humain… ». Agnostique, laïque
et républicain, il signe aussi, en 1942, la lettre collective organisée par Marc
Bloch et adressée à l’UGIF pour attirer l’attention sur la politique de Vichy
faisant des juifs une catégorie à part, prélude de la déportation. Son frère
Henri est raflé au Vel’ d’Hiv et déporté sans retour à Auschwitz.
La Guerre des 6 jours (1967) et Guerre du
Kippour (1973) devaient susciter chez maints israélites agnostiques le désir
d’un retour au Dieu des Pères. C’était trop tard pour le professeur Benveniste,
il n’a pas pris ce chemin. Le YHWH de son enfance rabbinique s’était
métamorphosé en cette « force
originelle à l’œuvre » de la Leçon 7, qui « transcende » toute autre
propriété du langage, mais dont on ne conçoit pas, insiste le linguiste,
« que son principe se trouve ailleurs que dans le langage ».
Toute son œuvre révèle un fidèle héritier de
la sécularisation européenne : le Professeur Benveniste est un enfant des
Lumières, conscient de sa dette
envers les institutions de la République.
Pourtant, quand l’aphasie ne lui laisse que la
rêverie d’un langage intérieur muet, l’élève de l’école rabbinique revient à l’imprononçable graphisme YHWH
qui connaît et interprète toute parole. Et puisque sa science linguistique
descend de l’onto-théologie juive-grecque-et-chrétienne, ce n’est pas la kabbale, mais le
graphème THEO qui en prend
nécessairement la place. Pour graver
l’imprononçable dans le corps de
son élève : je lui rappelais,
me disait-il, sa mère enseignante à l’Alliance Israélite Universelle en Bulgarie,
mon pays natal, où cette mère Maria était décédée sans revoir son fils.
Le graphème aura été l’indice
ultime qu’il m’a laissé de cette
« force originelle à l’œuvre » chez les êtres parlants, YHWH pour le
juifs, THEO pour les gréco-chrétiens, et que le théoricien du langage a
inlassablement déconstruit, en l’appelant
une « signifiance » : car son principe ne se trouve que dans l’expérience de l’énonciation
qui enserre et interprète la rencontre de nos subjectivités dans l’histoire.
Vous voyez, à quoi mène
la linguistique ! De quoi faire méditer nos corps parlant et
écrivant en ces temps d’austérité et de heurts de religions.
Telle fut pour moi la
« dernière leçon » de ce kabbaliste des Lumières. Je ne pouvais pas
ne pas vous transmettre cet instant, ce don.
Merci à Jean-Claude
Coquet et à Irène Fenoglio de m’en avoir donné
l’occasion.
Julia Kristeva
Le 7.06.2012
[1]
Et dont l’exemple le plus
concret est son Vocabulaire des
Institutions indo-européennes (2 vol. Ed.de Minuit, 1969).
[2]
Cf. E. Benveniste, PLG2, p. 229.
[3]
« Remarques sur la
fonction du langage dans la découverte freudienne », in PLG1, p. 78 ;
1956.
[4]
C’est Antoine Culioli qui réalise ce projet dans sa « théorie des opérations
énonciatives », en étudiant l’activité du langage à travers la diversité
des langues nationales.
[5]
Avec Roland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture (1953), Eléments de sémiologie (1965),
Jacques Derrida, De la grammatologie (1967), La Voix et le Phénomène (1967), et dans
le domaine littéraire, après le
« Nouveau Roman », avec Philippe Sollers, Drame (1965), Logiques (1968),Nombres (1968), L’écriture et l’expérience des limites (1971).
[6] Cf. E. Benveniste, Baudelaire, op.cit. [7] Cf. Ibid., p.10.
|