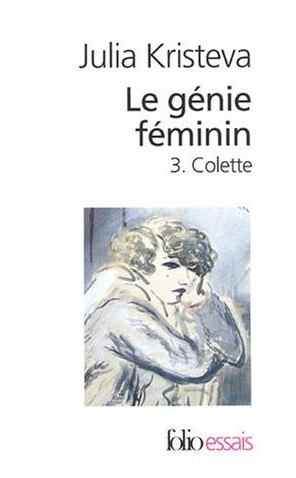|
Julia Kristeva
Colette ou la chair du monde
« Sauver la maison » de Colette participe non pas d'un culte, mais d'une initiation à la lecture de son oeuvre, dans
laquelle la langue française est inséparable de l'espace et du temps, ressentis
et incorporés. Une initiation à la lecture, tout simplement. Et je fais
un rêve: en visitant la maison natale de
Colette, les internautes dopés par hyperconnexions avec « éléments de
langage », parviennent peu à
peu à associer leurs mots dévitalisés aux choses, aux sensations,
pourquoi pas à l'histoire. La glycine bleue, le muret, le noyer, le lilas, Sido
avec son grand mot: « Regarde! » et le « coup de pied
unique » du Capitaine amputé
dans le chambranle de la cheminée en marbre...prennent corps. Nos paroles
aussi. Par quelle magie la maison
de Colette se prêterait-elle à cette incarnation? Mais parce que l'alchimie est déjà à l'oeuvre dans ses textes, plus immédiatement que chez d'autres
écrivains, et que La Maison en est le « gîte », le « centre et
le secret » où « je déchois de l'imposture ».
J’aime l’écriture de cette
femme : c’est un plaisir immédiat, sans « pourquoi » , mais je veux pourtant
tenter le pari d’une explication.
Colette a trouvé un langage pour
dire une étrange osmose entre ses sensations, ses désirs et ses angoisses,
ces « plaisirs qu’on nomme, à
la légère, physiques » et l’infini du monde - éclosions de fleurs, ondoiements de bêtes, apparitions sublimes, monstres contagieux. Ce langage transcende sa présence de
femme dans le siècle – vagabonde ou entravée, libre, cruelle ou
compatissante. Le style épouse les racines terriennes et son accent
bourguignon, tout en les allégeant dans une alchimie qui nous demeure encore mystérieuse. Elle-même l’appelle
un «alphabet nouveau»,« puissante arabesque de
chair ».
Provocante, scandaleuse par l’audace de
ses mœurs et de son parcours, cette
femme attachante
refuse de s’enfermer dans un quelconque militantisme et ne prêche aucune
transgression. Elle parvient à donner à son expérience de liberté sans complexe
le langage d’une profusion maîtrisée par une rhétorique classique, qui renvoie
les lecteurs modernes à la sérénité du miracle grec.
Fallait-il être
l’étrangère que je suis pour se laisser fasciner par sa sorcellerie, qui ne
serait donc pas seulement française, mais, peut-être,
sait-on jamais, universelle?
Son art «minutieux comme [d’]un primitif» impose et démontre que le plaisir lui-même est possible s’il comprend la
volupté en même temps que son prolongement dans une écriture, à la fois
« gai savoir » et « règle qui guérit de tout », enchantant
les uns et désolant les autres.
Je reçois, quant
à moi, son expérience tel un legs très précieux de la tradition française.
Pourtant, aveugle à la politique, et bien loin d’être
un exemple de lucidité historique, l’ingénue de la Débâcle préfère ne pas
savoir : sous l’Occupation, plutôt que de résister, elle emploie sa plume
imaginative à aider ses contemporains, souffrant des rationnements et de pénurie,
à mieux se nourrir. C’est seulement en repérant ses limites et ses impasses,
ses contradictions et ses paradoxes que le lecteur contemporain se laisse
conquérir par son génie affirmatif
dans ce qu’il apporte d’insolite au cœur de la tragédie humaine telle que l’a
exhibée le XXe siècle.
Au moment-même où Freud découvre
la psychanalyse en analysant les rêves des viennoises névrosées, Colette l’enracinée, Colette l’amoureuse, Colette
l’hédoniste exige son droit au
bonheur à tout prix et impose la sensualité désinhibée de ses Claudine. En défiant
aussi bien le refoulement qu’une certaine rigidité de l’interdit divin et
moral, ainsi que de la norme sociale elle-même. L’athéisme et l’amoralisme
devaient être les deux versants de cette exploration aussi plaisante que
risquée, lourde de portée métaphysique sous sa désinvolture et son caractère
scandaleux. Par un savoir plus inconscient que raisonné, elle accorde une
confiance totale à cette civilisation française à laquelle elle est fière
d’appartenir- de Villon et Rabelais à Balzac et à Proust, fondée sur la
séduction et ses logiques de mascarade, de mime, d’artifice, de déni, de
perversité, de mensonge - bref, d’imagination à la fois acide et salutaire,
empoisonnante et jouissive.
Étrange corps que
celui de Colette - si français -
qui se met en scène pour souffrir et jouir, dissocié, spasmodique, et surtout
rhétorique. Corps qui se plaît à exhiber ses étrangetés en créant de non moins
étranges harmonies en musique, en poésie et en philosophie. Transmuer la
sensation fiévreuse d'une passion dans ce plaisir de bouche et d'oreille qui
s'incarne dans les mots de la langue maternelle: voilà le seuil où l'humanité
parlante cherche sa vérité, et dont la justesse sensuelle de Colette ne s'écarte jamais.
. C’est bien à Colette la bacchante, dévorant hommes et femmes, roses et muguets, chiens et chats, que nous
devons cette sobre définition de la culture comme culte du mot : « Entre le
réel et l’imaginé, il y a toujours la place du mot, le mot magnifique et plus
grand que l’objet. » Et qui se permet cette tendre moquerie de la francité
qu’elle considère tout entière ciselée dans le joyau de la langue : « C’est une
langue bien difficile que le français. A peine écrit-on depuis quarante-cinq
ans qu’on commence à s’en apercevoir. »
Alors que les
grandes œuvres littéraires de ses consœurs européennes et américaines excellent
dans la mélancolie - d’Emilie Dickinson à Virginia Woolf en passant par Anna
Akhmatova-, c’est par son cantique de la jouissance féminine que Colette la
Française domine la littérature de
la première moitié du XXe siècle. Détestant les féministes, fréquentant les
homosexuelles et refusant de se laisser enfermer dans les mièvreries acides des
chapelles gomorrhéennes, elle impose néanmoins une fierté de femme qui n’est
pas étrangère, en profondeur, à la révolution des mentalités qui verra
s’amorcer lentement l’émancipation économique et sexuelle des femmes.
« Tu es plutôt
une femme comme il faut, mais d’un genre particulier. [...] Tu as le talent
d’écrire et d’intéresser le lecteur avec des choses... je ne puis dire des
riens car au fond ce ne sont pas des riens, loin de là, et je dois même
reconnaître que tu, avances de deux siècles à de nombreux points de vue. » Quel
meilleur guide que ces propos de Sido, sa mère, d’une tendresse sans
complaisance, et pour cela même prophétiques, pourrait nous accompagner dans la
lecture de ces « riens »? Et qui deviendront nôtres dans « le chaud
désordre d'une maison heureuse, livrée aux enfants et aux bêtes tendres ».
Sa maison enfin restituée à ses lecteurs: « le royaume » et
« le fantôme »; « la maison sonore, sèche, craquante comme un
pain chaud: le jardin, le village... » . Et ses livres, à la lecture.
Julia Kristeva
Le Génie Féminin, t.3, Colette (Fayard, 2002)
Mobilisation pour sauver la maison natale de Colette
|