Notes sur un Samouraï
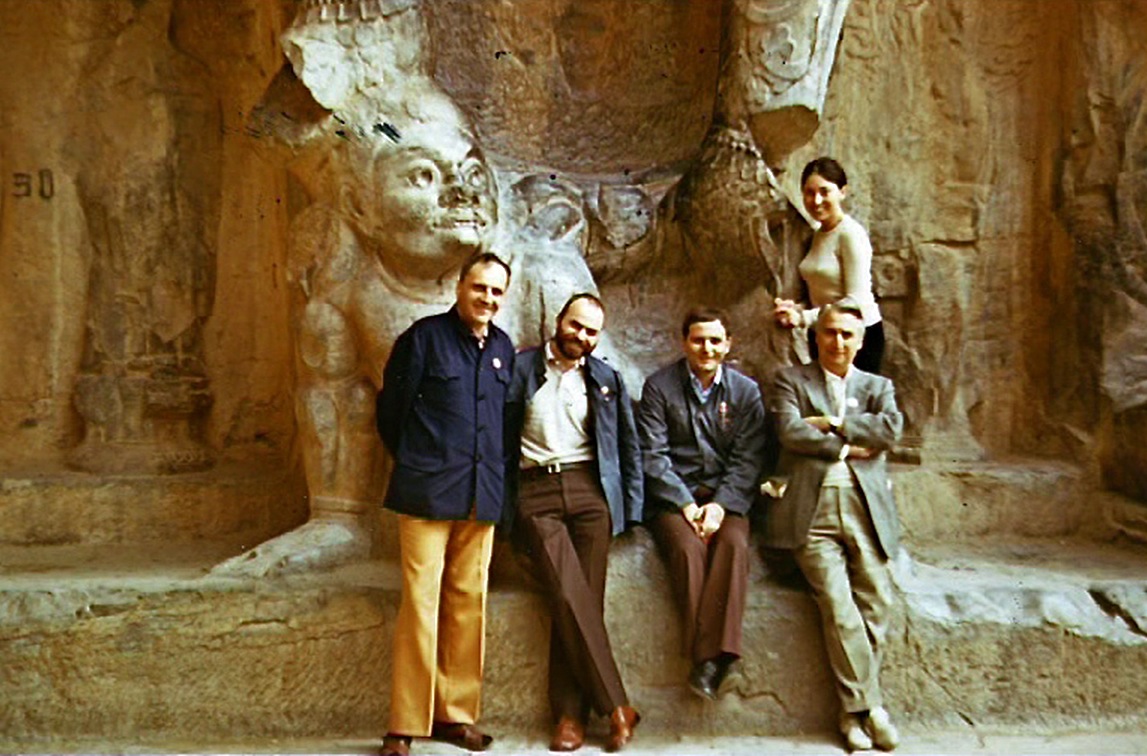 |
| Tel Quel en Chine, grottes de Longmen. |
Dans la démystification des mythes (le vin,
le fromage, les jouets, l’abbé Pierre, le poujadisme…), dans la tendre ironie
de sa voix et jusque dans le « non-vouloir-saisir » de l’écriture qui
perçait les apparences, les postures et les idéologies de tout bord, celles de
la sémiologie elle-même (pour qu’elle devienne une sémioclastie),
sans épargner l’« échec langagier de l’amoureux » « trop phrasé
pour relever de la pulsion, trop crié pour relever de la phrase », –
je percevais la rage du révolté. Elle s’appuyait sur la mortalité du
tuberculeux et sur sa destructivité qui puise et s’épuise dans une langue
française révélée à sa propre sensualité subjuguante :
« prolifération physique, corporelle, labiale » ; « un
Texte sur lequel je ne puis apposer aucun adjectif : dont je jouis sans
avoir à le déchiffrer ». Eclosion et éclipse du sens donc, méticuleuse
violence d’exister et/ou d’écrire.
La cohabitation de la parole avec la mortalité,
qui parvient à cet état de survivance qu’est l’écriture, m’est apparue dans ces
moments d’exil, où la langue d’origine s’écoule avec l’encre et renait par
l’investissement de l’autre langue, de la nouvelle. J’ai cru comprendre
à ces moments-là le mythe chrétien de la résurrection, hanté par la
destructivité et la finitude des hommes qui la défient par le culte de
l’imaginaire : musique, peinture, littérature. J’ai choisi le nom de samouraï pour désigner ces créateurs de langue (philosophes, linguistes, écrivains).
Dans la France qui m’accueillait, ils brisaient les codes sociaux et moraux,
ouvraient les frontières des identités et des sexes, mais aussi le
cloisonnement des disciplines universitaires. Exception française ?
Certainement. A condition de préciser que cette effervescence des paroles
(aujourd’hui hyperconnectées et qui ne parviennent pas à se formuler pour agir,
mais s’étranglent en colères, non sans déclencher le flot de commentaires
viraux et des « grands débats ») est un engagement psycho-sexuel de
tous les instants, qui porte le soi hors de soi. Affranchissement du religieux,
traversée et refondation des limites et des lois, désirs à mort et élucidations
risquées, obsédant lègue… de la Révolution Française. Piégée par les nouvelles
astuces de la finance et de la Toile ? Ou voluptueux pari sur la plénitude
du langage pour demain, pour plus tard, ou pour jamais ?
« Le peuple français semble avoir devancé
de deux mille ans le reste de l’espèce humaine, on serait tenté même de le
regarder au milieu d’elle comme une espèce différente » : la phrase
de Robespierre à la Convention parait pathétique, démentielle. « Et si
c’était vrai ? Les révolutionnaires français ont vécu en parlant sans
cesse, pour mourir très vite », écrit Philippe Sollers dans son dernier
roman, Désir (Gallimard, 2020).
Aujourd’hui nous ne sommes pas pressés car
nous savons calculer les pénibilités dont nous parlons sans cesse pour
prolonger la finitude.
Barthes fut pour moi un de ces Samouraïs (1990),
le plus proche, si l’on peut parler de proximité pour évoquer son élégante
simplicité secrète. Sous le nom d’Armand Bréhal, il apparait dans mon roman Samouraïs,
tel que son enseignement me l’a révélé dès les premiers séminaires. En
résonnance avec Proust (que son « plaisir du texte » m’a permis
d’apprivoiser avec le temps) : une thérapie de l’être-pour-la-mort,
par la traversée de la caverne sensorielle que recèle le langage :
[…] la voix de Bréhal […] tissait des
correspondances à l’aide d’un vocabulaire érudit mais gracieux, pour y
déchiffrer l’anamorphose amoureuse du narrateur devenant une femme
superficielle. Enfin le souvenir sonore changeait en surface colorée –
« la rose carnation d’une fleur de plage » –, mais
c’était toujours la métaphore d’une seule et même sensualité, celle du
narrateur irisé d’amour.
Ainsi, disait Bréhal, l’amour serait le temps
devenu sensible. Pas du tout une affaire d’organes, ni même d’esprit en feu,
mais un pacte de mots basculant en souvenirs perceptibles. Des paroles qui se
rappellent avoir été des perceptions de sons, de couleurs, de parfums. Proust
amoureux invente une histoire pour faire revivre au narrateur épris d’Albertine
ce transport de l’esprit et des sens qui est le véritable élément de la
passion. Proust se souvient-il d’Albertine, de Méséglise,
de son enfance, ou bien des correspondances de Baudelaire ? Métamorphose
mystique de tous les sens confondus en un…
On le voit ensuite dans nos rencontres et
discussions, professeur et élève cherchant ce qu’il appelait souvent « le juste,
au sens musical du terme ».
Il la regarda de nouveau avec cette étrange
douceur qui s’achevait en indolence, comme si craignant d’être ridicule, il
s’interdisait de verser dans une sorte de tendresse maternelle.
[…] Le nez découpé en ouvre-boite, penchait
asymétriquement à gauche et lui donnait, au gré des circonstances et des jeux
du visage, un aspect simplet ou insolent. Le regard et la bouche affichait sans
frein le plaisir – ou, très facilement, l’ennui – qu’il éprouvait à
écouter les autres.
La toux secouait le corps en cascades sourdes,
irrépressibles. Un corps qui avait dû être malade et, qui, affaissé, sans
articulation sous la coupe soignée des costumes, semblait n’avoir jamais servi,
sinon à quelque plaisir solitaire sans fatigue. Il était plutôt mince, malgré
les bajoues et le ventre qui commençait à s’alourdir. Mais son allure dégageait
un calme rassurant, et le rythme de sa démarche était si mesuré, si élégant,
que tout en lui suscitait irrésistiblement l’attachement.
Sous la Grande Muraille de Chine, la Voie Sacrée
des Ming est une vallée d’animaux souvent surnaturels et de personnages
forcément très hauts, tous en marbre étincelant, qui donnaient à cette
nécropole un air de Disneyland éternel. La mort est blanche en Chine, devait
penser Bréhal : est-elle vraiment un soulagement sans le feu de l’enfer ni
le tourment de la passion ?
Il continuait à écrire dans son carnet, yeux
fermés pour le dehors, tout entier en voyage dans son monde à lui. Que voir de
plus sur ces pierres éblouissantes ?
En s’asseyant à la dernière place de la
rangée réservée à notre délégation, avec l’espoir d’avoir en voisin l’éventuel
amant chinois, Bréhal s’exposait évidemment aux foudres du service d’ordre.
Provocation inconsciente, ou irrésistible pulsion, semer le désir dans le
troupeau des masses risquait le scandale ! Voire le procès de l’éminant
professeur, déchu au rang de « mauvais élément », que je décris… en
italique dans mon roman :
rien qu’une hypothèse, frayeur imaginaire… on l’a échappé belle.
Ses derniers instants convoquent de nouveau
l’indécidable récit : un accident ; inconsolable deuil de sa mère,
béance de la « chambre claire » ; insoutenable malaise dans le
carnaval social ; la mélancolie en bandoulière de l’ironie. Et toujours ce
« non-vouloir-saisir », cette fois-ci de la vie elle-même.
– Armand… accident de la circulation… Si,
très grave… En réanimation aux urgences… Je te retrouve à l’hôpital.
[…]
– Tu crois au hasard, toi ?
– Il avait la déprime.
– Ce deuil de sa mère l’a tué.
– Non, tu n’as pas vu les mauvaises
critiques sur son livre ? Il était très atteint.
– Les pontes de l’Université n’aiment pas
son enseignement : « Trop mondain, trop public, trop aimé, trop ceci,
pas assez cela. » Il le savait, ça l’humiliait.
[…] Olga se souvenait de ce que lui avait dit
tristement Armand, environ une semaine auparavant : « J’ai envie de
me mettre la tête dans le plâtre. »
– Bizarre, on ne dit pas ça en
français ; on dit « dans le sable », non ?
– On peut tout dire quand on est Armand,
avait répondu Hervé. Mais c’est vrai qu’il n’a pas la forme, il prétend qu’il
veut se ranger des voitures.
[…] le corps qui s’était rendu célèbre en
formulant une sensualité réfléchie ne répondait plus. Les yeux perlés de
fatigue et de médicaments, le visage las, il lui fit un de ces gestes d’abandon
et d’adieu qui disent : « Ne me cherchez plus, à quoi bon…. Comme
c’est casse-pieds, la vie. »
Rien de plus convaincant que le refus de vivre
quand il est signifié sans hystérie : aucune demande d’amour, simplement
le rejet mûr, pas même philosophique, mais animal et définitif, de l’existence.
On se sent débile de s’accrocher à l’agitation appelée « vie » […].
[…]
– De toute façon, ils le redécouvriront.
Tôt ou tard. Tu sais pourquoi ? Parce qu’il a écrit comme il a vécu :
en sursis. Le sursis rabaisse les choses et met de la musique dans les paroles.
A condition d’avoir la grâce qui transforme un corps défaillant en instrument
de langage. C’est mystérieux, mais ça arrive. Alors le sursis rend les gens
stylistes. Même quand ils sont profs de sémantique. Armand était un type malade
qui a toujours frôlé la mort : elle freinait ses plaisirs, mais elle lui
donnait aussi cette petite fièvre qui module sa phrase pas comme celle des
autres. On n’écrit que depuis la mort, rappelle-toi ça – ou de solitude,
tu verras toi-même.
JULIA KRISTEVA
Cf. aussi: Julia Kristeva, "Se réinventer en étrangère", propos recueillis par Marie Fouquet et Tiphaine Samoyault, Dossier "Roland Barthes, myhthologies d'aujourd'hui", Le Nouveau Magazine Littéraire, avril 2020: https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/se-réinventer-en-étrangère